L'Homme
qui rit, Victor Hugo, 1869
|
||
 Portrait de Victor Hugo, 1867. Photographie de Bertall (1820-1882). |
A la fin de son
manuscrit, Victor Hugo
fournit ces précisions "Terminé le 23 août 1868, à dix heures et demie
du matin. Bruxelles, 4, place des Barricades. Ce livre, dont la plus
grande partie a été écrite à Guernesey, a été commencé à Bruxelles le
21 juillet 1866 et fini à Bruxelles le 23 août 1868." Comme on le voit,
Hugo ne craignait pas la redondance. (Cité en note de l'édition
Bouquins, Romans II, 1985)Contexte de rédaction et de publication.Depuis le coup d'Etat de Louis Napoléon Bonaparte en décembre 1851, devenu Napoléon III l'année suivante, Hugo vit en exil. Il a fixé sa résidence dans l'île anglo-normande de Guernesey, depuis 1855. Il y a acheté une maison, baptisée Hauteville House, grâce à la vente des Contemplations. La propriété l'héberge, lui et sa famille, mais surtout elle est la garantie qu'il ne peut être expulsé puisque propriétaire. Hugo ne tient pas à renouveler l'expérience de Jersey dont il avait été expulsé en octobre 1855. Il fait de fréquents voyages à Bruxelles puisque, depuis 1864, sa femme, Adèle, et ses enfants y passent une grande partie de l'année et que c'est aussi la ville de son éditeur, depuis 1862, Albert Lacroix, d'où les précisions spatiales du manuscrit.En exil, Hugo est devenu très vite la grande voix des Républicains et des opposants au second Empire, lui, l'opposant de la première heure qui, alors député, avait mis en garde contre les projets d'un président de la République ambitionnant un pouvoir à long terme. Son expérience, ses sentiments, ses réflexions sur le pouvoir, les ambitions de certains, vont alimenter ce roman, en particulier, fournir un certain nombre de traits au personnage de lord Clancharlie. Hugo fait précéder son texte d'une brève préface où il énonce : "Le vrai titre de ce livre serait l'Aristocratie", en en faisant le premier volet de ce qui devrait être une trilogie. Il devait être suivi de "La Monarchie" (qui ne sera jamais écrit), puis du dernier,"la Démocratie", Quatrevingt-treize (publié, lui, en 1874). Il inscrit ainsi son roman dans une réflexion socio-politique portant sur les rouages du pouvoir et leur évolution en partant de la féodalité; c'est pourquoi il prend, comme particulièrement démonstratif pour ce premier volet, la monarchie anglaise au XVIIe siècle qui sert de cadre à l'action, et s'y intéresse particulièrement à la chambre des Lords. Dans une édition de 1907, établie par Gustave Simon, l'écrivain (qui est aussi l'un des exécuteurs testamentaires de Hugo) donne un certain nombre de notes et reliquats qui permettent d'éclairer le projet hugolien. Par exemple, cette note datée du 22 mai 1868 : "Si l’on demande à l’auteur de ce livre pourquoi il a écrit l’Homme qui Rit, il répondra que, philosophe, il a voulu affirmer l’âme et la conscience, qu’historien, il a voulu révéler des faits monarchiques peu connus et renseigner la démocratie, et que, poëte, il a voulu faire un drame" et il précise, dans une autre note, non datée, qu'il y deux sortes de "drames", ceux que l'on peut jouer et celui qui ne peut l'être parce qu'il "participe de l’épopée. Aux personnages humains il mêle, comme la nature elle-même, d’autres personnages, les forces, les éléments, l’infini, l’inconnu." Enfin, la trilogie évoquée dans la préface de 1869, est éclairée par cette note du 31 mai 1868 : |
|||
|
"Il n’y a pas d’autre lecteur
que le lecteur pensif.
Celui-là comprendra pourquoi l’auteur de l’Homme qui Rit a cru utile de publier ce livre, où est peinte l’ancienne Angleterre, avant le livre où sera peinte l’ancienne France, qui aura pour conclusion la Révolution et qui sera intitulé : Quatrevingt-treize. L’Angleterre après 1688, la France avant 1789, tels sont les deux pôles de l’immense fait européen qui a produit la Révolution, française encore aujourd’hui, avant peu universelle." Un grand projet, mais un échec éditorial. Le roman déconcerte, même si Zola en fait une recension admirative dans Le Gaulois du 20 avril 1869 et si Rimbaud en apprend par coeur des morceaux entiers. Et quoique toujours publié, aujourd'hui, dans les collections de poche, le projet de l'éditer en Pléiade, annoncé en 1985, n'est toujours pas réalisé en 2020. Il faut croire que les lecteurs contemporains sont tout aussi réticents que ceux de 1869. Victor Hugo en avait eu conscience et en avait tiré cette réflexion : "Il m’importe de constater l’insuccès de l'Homme qui Rit. Cet insuccès se compose de deux éléments : l’un, mon éditeur ; l’autre, moi. Mon éditeur. — Spéculation absurde, délais inexplicables, perte du bon moment, publication morcelée, retards comme pour attendre le moment d’engouffrer le livre dans le brouhaha des élections [on peut en lire le détail dans les notes de Gustave Simon]. Moi. — J’ai voulu abuser du roman, j’ai voulu en faire une épopée. J’ai voulu forcer le lecteur à penser à chaque ligne. De là une sorte de colère du public contre moi." Sa note de mai 1868 le disait déjà en décrivant son roman comme étant, à la fois, une oeuvre d'historien, de poète, de philosophe, ce qui était, en effet, jeter le lecteur sur des pistes si multiples qu'il courait fort le risque de s'y perdre. Les hésitations sur le titre :Le roman s'est d'abord intutlé "Lord Clancharlie" ce qui orientait sa lecture dans le sens d'une réflexion sur des choix politiques individuels dans leur rapport avec l'évolution historique. Le personnage, en dépit de son statut de "lord", choisit de se rallier à Cromwell, donc à la République, et lors de la "restauration" (1660), après la mort de Cromwell et l'abdication de son fils (1659) qui rappelle au pouvoir Charles II, fils du monarque exécuté, lord Clancharlie s'exile.Il s'est ensuite intitulé "Par ordre du roi" avec pour sous-titre, ou titre alternatif puisqu'il suit toujours le premier tout en étant entre parenthèse, "l'homme qui rit". Celui-ci invitait à suivre les pistes de l'absolutisme, car cet ordre du roi est celui qui vise à se débarasser, de toutes les façons possibles, de ceux qui gènent. On le voit se manifester de diverses manières dans le roman, dans des actions parfois terribles, d'autres fois tout aussi terribles mais dont les apparences peuvent sembler anodines, interdire les saltimbanques, fermer une taverne, enlever, torturer, défigurer, exiler, menacer de mort, voire exécuter à l'occasion, disposer d'un titre ou d'une fortune. Ce titre est encore celui que lui donne Hugo dans le contrat signé avec Lacroix en septembre 1868. Il ne se décide vraiment pour" l'Homme qui rit" qu'en novembre 1868, comme il l'écrit dans une lettre du 25 : "En choisissant d’abord Par ordre du Roi, je voulais accentuer tout de suite la partie démocratique du livre. Cet effet est, je crois, maintenant produit, et je puis sans inconvénient, comme vous l’indiquez et comme je l’avais moi-même toujours cru meilleur, donner au livre le titre de l’Homme qui Rit et à la deuxième partie le titre : Par ordre du Roi." On voit, à travers ce commentaire, qu'il s'agissait bien de dénoncer "le bon plaisir" royal, donc de porter témoignage à charge contre la monarchie et, par la même occasion, contre tout ce qui y ressemblait, le second empire français, au premier chef ; le narrateur n'écrit-il pas à propos de lord Clancharlie exilé " "Quoi au-dessus de l'ordre reconstitué, de la nation relevée, de la religion restaurée, faire cette figure sinistre !" (II, I, 1-3), où l'on retrouve quelques titres des diverses parties de Châtiments, 1853. |
||||
Une oeuvre d'historienBien que ce ne soit que le deuxième aspect que souligne la note de mai 1868, il est nécessaire de commencer par là, en raison de l'importance du cadre dans lequel se meuvent les personnages et se déroule l'action.Il ne s'agit pas pour autant d'un roman historique, comme le rappelle Hugo en tançant son éditeur d'avoir organisé sa publicité sur une telle affirmation: "Le roman historique est un très bon genre, puisque Walter Scott en a fait, et le drame historique peut être une très belle œuvre puisque Dumas s’y est illustré ; mais je n’ai jamais fait de drame historique ni de roman historique. [...] Par ordre du Roi sera donc l’Angleterre vraie, peinte par des personnages inventés [c'est nous qui soulignons]. Les figures historiques, Anne, par exemple, n’y seront vues que de profil. L’intérêt ne sera, comme dans Ruy Blas, les Misérables, etc., que sur des personnages résultant du milieu historique ou aristocratique d’alors, mais créés par l’auteur." Le temps du récit se distribue en deux époques : le mois de janvier 1690 (Première partie, une seule nuit) ; l'année précédente, Jacques II, successeur de Charles II, a été destitué et le trône est passé aux mains de sa fille aînée Marie et de son époux, Guillaume d'Orange-Nassau ; cet événement justifie la fuite des "comprachicos" et l'abandon de l'enfant Gwymplaine sur la côte de Portland. Après une longue ellipse occupée par l'évocation de l'univers du pouvoir, le fil historique se renoue en 1705 (deuxième partie, Livre II). La reine Anne (soeur de Marie, morte sans enfant) est au pouvoir depuis 1702. Hugo "historien" s'intéresse peu aux événements, beaucoup plus aux atmosphères, aux idéologies (dans le sens péjoratif que leur donne Marx, la justification de comportements injustifiables, d"où cette formule du poète "humain dans certains cas signifie inhumain"). Ainsi décrit-il les comportements ordinaires de l'aristocratie, son mépris absolu de qui n'appartient pas à son rang. Le non noble est au mieux ignoré, au pis traité comme un "jouet" propre à divertir l'ennui de ceux qui ont tout (On trouve déjà cela dans Le Page disgracié de Tristan Lhermite, 1643, rapportant un certain nombre de ces "blagues", de notre point de vue plutôt sinistres). Cette disproportion entre deux parties de la société, le très petit nombre de ceux qui ont tout, le reste qui n'a rien, même pas le droit de s'en plaindre, le roman l'affiche dans sa diégèse, comme son héros Ursus le fait dans la liste des droits des lords, et de leur détenteurs que ce dernier possède dans sa cahute pour que cette vérité ne le quitte jamais des yeux, car est-ce lui qui regarde les listes, ou les listes qui pèsent de leur poids de vie ou de mort, sur lui, et ses semblables ? Hugo aime les listes (le lecteur un peu moins) mais celles-ci disent beaucoup. La liste des Lords, qui comprend 23 noms, est agrémentée de tous leurs titres et possessions, tant en châteaux qu'en terres, pour certains. Moralité, elle rend visible la disproportion entre les tenants du pouvoir et les autres. A cette liste va s'opposer la vision des spectateurs venant voir les saltimbanques, la densité de la foule et sa misère qui se révèlent aux yeux de Gymplaine : "Ce qui venait à lui [Gwymplaine] c'étaient les faibles, les pauvres, les petits. [...] Ces bouches d'enfants n'avaient pas mangé. Cet homme était un père, cette femme était une mère, et derrière eux on devinait des familles en perdition. Tel visage sortait du vice et entrait dans le crime ; et l'on comprenait le pourquoi ? ignorance et indigence..." etc. (II, II, 10, éd. Bouquins, p. 557) Le tableau ne serait pas complet si n'y apparaissaient les moyens de coercition, car si le pouvoir peut s'appuyer sur la passivité des pauvres réduits au statut de troupeau, ce troupeau est instable, et la force doit se tenir prête. Elle se manifeste dès le début du roman par le pendu goudronné sur la côte de Portland avisant de leur avenir les potentiels contrebandiers, elle se manifeste dans les rues de Londres par le "Wapentake", officier de justice chargé, dans le silence, d'assurer les prises de corps. Cette vision d'une justice assimilée à une fatalité, à laquelle le justiciable ne comprend rien, est proposée dans un récit particulièrement oppressant qui est celui de l'arrestation de Gwymplaine (ou de ce qui y ressemble) auquel le roman consacre tout le quatrième livre de la seconde partie intitulé "La cave pénale", où rien ne manque, pas même la torture. Le tableau trouve son apothéose dans la tentative de discours-réquisitoire de Gwymplaine à la chambre des Lords, accueilli par des éclats de rire et des quolibets, qui ne sont pas sans rappeler ceux dont a bénéficié le député Hugo tentant d'alerter ses collègues sur la misère du pays, sur les ambitions du prince-président, ou plaidant en faveur de la construction de l'Europe, en plein milieu du XIXe siècle. Le roman avertit d'ailleurs : "Cela se passait il y a cent quatre-vingts ans, du temps que les hommes étaient un peu plus loups qu'ils ne sont aujourd'hui." et d'ajouter "pas beaucoup plus." ( I, I, éd. Bouquins, p. 355) |
 25 avril 1869, L'Eclipse annonce le "nouveau livre de Victor Hugo". L'illustration est de Gill qui fait du loup le "premier de cordée" dont le bébé Dea est le dernier. L'extrait qui accompagne la Une est précédé de ces mots : "Il convient aujourd'hui de céder la place au maître des maîtres./ L'Homme qui rit vient de paraître.../ Empressons-nous de détacher une tranche de l'oeuvre substantielle et robuste de Victor Hugo, et servons-la en régal et en primeur à nos lecteurs." L'extrait choisi, intitulé "Effet de neige", raconte la découverte de Dea par Gwymplaine, en I, III, 2. |
 Victor Hugo, le phare des Casquets, 1866 (Plume et lavis d'encre noire, pierre noire, crayon noir, gouache, utilisation de barbes de plume, sur papier vélin) Le phare est décrit en I, II, 11 où il est présenté ainsi: "Un phare au dix-neuvième siècle est un haut cylindre conoïde de maçonnerie surmonté d'une machine à éclairage tout scientifique. [....] Au dix-septième siècle un phare est une sorte de panache de la terre au bord de la mer." |
drame / épopée : la création poétiqueDans le contexte historique que nous venons d'ébaucher, le poète inscrit son drame, dont il a prévenu qu'il "participe de l'épopée".Pour un drame, il faut un décor. Celui-ci va différer de la première à la deuxième partie. Dans la première, jouent les éléments naturels, la mer et la côte, les vents et la neige, l'hiver et la nuit. Dans la seconde, le décor est urbain, les actions se déroulent dans la ville de Londres. D'un côté, le monde "naturel", impitoyable à sa façon, puisque ne tenant aucun compte des microbes (au sens strict du terme "personne chétive, petite") que sont les hommes à la surface de la planète, la mer détruisant le navire, le froid et la neige tuant les pauvres ; de l'autre, l'univers humain tout aussi impitoyable, où de grands prédateurs s'engraissent de la faiblesse des petits, et le narrateur de rappeler les taxes et les impôts qui s'abattent sur les seconds pour alimenter les caisses des premiers. Dans l'une et l'autre partie, le narrateur s'attarde longuement sur la description de ces milieux, en ne négligeant pas de comparer ce passé au présent de l'écrivain. Ce qui pourrait sembler digression joue sa partie sur plusieurs plans, d'une part dans la réflexion de l'historien sur la complexe relation entre le temps et l'histoire, celle du philosophe qui reconnaît dans les altérations, modifications des falaises de Portland avec ses conséquences sur la faune et la flore, le rôle de "facteur géologique" joué par l'homme, tout autant que dans les modifications architecturales allant de pair avec les transformations des moeurs, enfin celle du poète constatant de manière implicite ce que disait Baudelaire dans "Le Cygne", 1860, poème d'ailleurs dédié à Hugo : "La forme d'une ville / Change plus vite, hélas ! que le coeur d'un mortel." Il faut des personnages. Quatre forment le noeud du drame. L'encadrant (ils sont antérieurs à l'action, et restent seuls à la fin), les deux personnages que sont Ursus et Homo, présentés dans le premier des "deux chapitres préliminaires". Le premier est un vieux misanthrope, qui se donne tous les dehors d'un cynique, croûte passablement âpre renfermant en vérité un esprit érudit et fin, une âme sensible et, comme le dit le langage populaire, un "coeur d'or". Le second est un loup, personnage symbolique dans un pays qui a éradiqué les loups vers la fin du XVIe siècle. Ursus s'est baptisé lui-même ainsi (et le lecteur ne connaîtra jamais son nom) et a baptisé son loup, dans lequel il voit son double, son alter ego, à qui il enjoint régulièrement ce conseil : "Surtout ne dégénère pas en homme". La relation des deux personnages est presque fusionnelle : "Ursus avait communiqué à Homo une partie de ses talents, se tenir debout, délayer sa colère en mauvaise humeur, bougonner au lieu de hurler, etc. ; et de son côté le loup avait enseigné à l'homme ce qu'il savait, se passer de toit, se passer de pain, se passer de feu, préférer la faim dans un bois à l'esclavage dans un palais." (I,1-2) Où l'on voit que le loup est toujours, comme dans la fable dont il paraît directement issu, l'allégorie de la liberté. Ursus mène une vie itinérante et gagne leur vie en soignant et vendant des remèdes qu'il fabrique à base de plantes. Les deux autres personnages, Gwymplaine et Dea, apparaissent dans le monde d'Ursus et Homo une nuit de janvier 1690. Gwymplaine est alors un garçon de dix ans, environ, dont le visage a été mutilé pour en faire un masque de clown affublé d'un rire perpétuel. Personnage aux apparences grotesques, il possède un grand courage, une énergie à toute épreuve, de la générosité (d'une certaine manière cela en fait le frère de Quasimodo). Il se charge de Dea, découverte sur le corps de sa mère morte, alors que le bébé est lui-même à moitié mort. Ursus les recueille, les nourrit et baptise la petite fille Dea, pour sa beauté, sa cécité, et pour compléter le microcosme que représente leur "famille" : "Ursus, maniaque de noms latins, l'avait baptisée Dea. Il avait un peu consulté son loup ; il lui avait dit, tu représentes l'homme, je représente la bête ; nous sommes le monde d'en bas ; cette petite représentera le monde d'en haut. Tant de faiblesse, c'est la toute puissance. De cette façon l'univers complet, humanité, bestialité, divinité, sera dans notre cahute. — le loup n'avait pas fait d'objection." (II, II, 2) Dea est aveugle et aime Gwymplaine, lequel, en retour, adore l'enfant, puis la jeune fille qu'elle est devenue, 15 ans après la nuit de janvier 1690. A l'encontre de la robustesse de Gwymplaine, Dea est fragile, Ursus soupçonnant, avec raison, des problèmes cardiaques. Et chose intéressante quoiqu'inhabituelle, il y a un personnage in abstensia : Lord Clancharlie, auquel sont consacrés deux chapitres du livre premier de la seconde partie. Le personnage exilé est mort au moment du récit. Mais il est l'occasion de méditer sur le statut d'exilé politique. Au fond, ici, Hugo répond à ses détracteurs : "Il est désagréable de voir les gens pratiquer l'obstination." (II,I, 1-2) la réflexion qui suit, donnant la parole aux tenants du fait accompli, est un modèle d'ironie amère. |
|||
 Victor Hugo, non daté. (Plume, encre brune et lavis, sur un feuillet d'album) |
Pour qu'il y ait drame, il faut des antagonistes. A l'opposé de la faiblesse, la puissance, incarnée d'une part dans la duchesse Josiane, fille naturelle du roi Jacques II et donc demi-soeur de la souveraine, la reine Anne ; Lord David Dirry-Moir,
fils naturel de Lord Clancharlie auquel le roi promet l'héritage de ce
père en exil à condition qu'il épouse la duchesse Josiane puisque c'est
elle qu'il en a doté après confiscation des biens de l'exilé. Ces deux
personnages ne sont, en réalité, que des marionnettes de leur classe
sociale. Ils en ont tous les travers, et même certaines qualités, par
exemple la générosité, même si elle est davantage fondée sur l'égoïsme
(il faut qu'elle soit amusante) que sur l'altruisme, le courage, pour
ne pas dire l'audace, mais dans le même temps une farouche indifférence
à tout ce qui n'est pas leur bon plaisir, d'où ce que le lecteur
contemporain pourrait juger une certaine perversité dans le choix de
leurs divertissements, la vie des trop riches est monotone et tourne à
l'ennui, d'où la quête du "piquant". Leur beauté physique à tous
deux n'a égale que leur élégance : "Etre élégant, c'est tout. Caliban
élégant et magnifique distance Ariel pauvre." (II, I, 3-1) Comme le
faisait remarquer Théodore de Banville, il faut peu de mots à Hugo pour
reconduire ses personnages à leur fatuité et leur vacuité. L'opposition des deux groupes est totale. Dea et Gwymplaine sont tout intériorité, Josiane et David, tout extériorité. Mais derrière cette puissance ostensible, il y a les menées souterraines d'un personnage bien particulier, Barkilphredo, qui est la laideur extérieure et la laideur intérieure. Il doit tout à Lady Josiane, c'est pourquoi : "Il y a d'abord une chose pressée : c'est d'être ingrat ; [...] Ayant reçu tant de bienfaits de Josiane, naturellement, il n'eut qu'une pensée s'en venger" (II, 1,7). Le narrateur développe avec beaucoup de finesse et d'acuité la progression du ressentiment dans l'esprit du personnage. L'action du drame naît de ce ressentiment que le hasard va bien servir. Le malheur est, en fait, pour sa plus grande part, le résultat involontaire d'agissements ne visant qu'à satisfaire des égoïsmes. Barkilphredo dévoile le secret dont il a eu connaissance dans l'espoir de voir lady Josiane privée de tous ses biens rendus à leur légitime propriétaire, c'était compter sans l'intervention de la reine : qu'à cela ne tienne, elle épousera l'héritier légitime. Mais de cette volonté mauvaise découlent, par ricochet, les malheurs qui vont frapper directement Ursus et Homo, condanmés à l'exil, indirectement Dea, dont le coeur ne résiste pas à la souffrance d'être séparée de Gwymplaine. Pour les heureux, rien n'aura vraiment changé. Barkilphredo en est pour ses frais. Les autres personnages de l'histoire ne jouent que des rôles épisodiques (y compris la reine comme en avisait l'auteur). |
Le livre du philosopheCe qui frappe d'emblée à la lecture de l'Homme qui rit, c'est la violence du texte. Le ton oscille le plus souvent entre l'ironie et le sarcasme et celui du narrateur est relayé par celui d'Ursus qui regarde le monde avec colère "Il était dans la nature celui qui fait de l'opposition" (I, I-4), qui n'arrive jamais à s'accomoder du fait que tout va mal, au point qu'il en néglige les petits bonheurs occasionnels, voire continuels que lui donne la présence du loup amical et des deux enfants qu'il élève avec amour. Cette colère perpétuelle vient de ce qu'il a "tiré au clair que la vie humaine est une chose affreuse, ayant remarqué la superposition des fléaux, les rois sur le peuple, la guerre sur les rois, la peste sur la guerre, la famine sur la peste, la bêtise sur le tout..." (I, 1-4)L'omniprésence du mal Le roman passe ainsi en revue le Mal sous toutes ses formes. D'abord le mal inévitable dû aux éléments, aux intempéries. Ainsi la première partie développe-t-elle la tempête en mer, avec un grand luxe de détails, au bout de laquelle naufrage le navire, et la tempête à terre, sur un paysage accidenté et inconnu où un enfant, en proie au froid et à la faim, tente de trouver une sortie, un chemin vers les hommes qu'il espère hospitaliers. Erreur ! La nature est indifférente, mais les hommes sont impitoyables. Les pauvres par manque de moyens, les riches, par indifférence, à peu près comme la nature à qui il importe peu d'avoir affaire à des criminels ou des innocents. A l'exception des quatre héros (et encore, parfois, leur arrive-t-il d'errer, eux aussi, Ursus en se découvrant de l'ambition, aller à Londres pour davantage de succès, Gwymplaine en se laissant tenter par Josiane, se leurrant sur son intérêt pour lui et croyant à un désir s'adressant à sa personne et non ce qu'il représente comme transgression, saltimbanque grotesque, seuls Dea et Homo restent fidèles à eux-mêmes), tous les autres personnages sont marqués de défauts pouvant tourner au vice, ce qui se produit dans le parcours de Barkilphedro qui, au départ, ne cherche qu'à assurer sa survie et, progressivement, en vient à désirer le pouvoir qui lui permettrait, non de s'accomplir, mais de se venger des offenses réelles ou imaginaires dont il se sent la victime. |
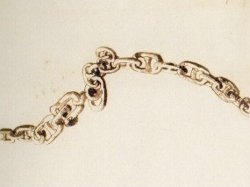 Victor Hugo, "chaîne de navire", 1864, plume et encre brune. La chaîne comme image de la fatalité. |
|||
| Empêcher autrui d'être heureux puisqu'il ne pourra jamais être à sa
place. Mais Josiane ne vaut guère mieux qui veut Gwymplaine comme un
trophée. Même David qui n'est pourtant pas un mauvais homme, s'amuse de
la souffrance d'autrui quitte à tenter de la réparer ensuite (II, I,
4). Chacun se réjouit du malheur d'autrui quand il ne tente pas de le
provoquer. Si bien que le mal, sous toutes ses formes, en vient à apparaître comme une fatalité. Sans parler des pulsions, la pulsion sexuelle n'étant pas la dernière. Hugo consacre de belles pages inquiétantes aux agitations de Gwymplaine pris dans les concupiscences, celles de la chair comme celles de la vanité. Mais le mal n'est pas une fatalité. Comme le montre Homo, loup pourtant, mais dont le comportement s'est, en somme, "civilisé" au contact d'Ursus, dans l'amour des enfants à l'éducation desquels il a participé, comme le développe le narrateur "philosophe" dans son évaluation du rôle des éléments naturels dans la transformation qui va affecter la vie des habitants de la "Green Box" (nom de la roulotte d'Ursus et compagnie) : est-ce fatalité ou providence (II, V, 2) ? Devant le mal, "Contre la Fatalité l’homme a deux armes : la conscience et la liberté ; la conscience qui lui indique le devoir, la liberté qui lui signale le droit." Cette liberté, qui est d'abord celle de l'esprit refusant de se soumettre, Ursus en témoigne, par exemple, dans sa confrontation avec les "docteurs" qui vont décider de son droit à donner spectacle (il a été dénoncé par la jalousie des forains alentour), où fait merveille sa finesse ironique. Le lecteur se réjouit de voir la sottise vaincue par la sottise maîtrisée devenue arme (II, III, 6). Ursus se joue des superstitions, des savoirs non maîtrisés de ses adversaires, par exemple, à l'accusation "— On dit que vous guérissez les malades !" il rétorque "— je suis victime des calomnies." soulignant l'absurdité dans laquelle vivent ceux qui prétendent le juger. |
 Victor Hugo, "la conscience devant une mauvaise action", 1866, plume et lavis d'encre brune sur vélin. |
|||
| Construire une réponse politique | ||||
| Le roman montre les maux de la société sous tous leurs aspects : de la
bêtise envieuse du voisin à la cruauté imbécile du jeune aristocrate en
mal de distraction, de la misère écrasant le grand nombre à l'insolent
gaspillage des gouvernants, de l'évitable qui dépend des hommes à
l'inévitable qui dépend du ciel, au sens matériel du terme, les
saisons, les intempéries. Mais si le mal est omniprésent, c'est que les bénéficiaires du pouvoir le veulent ainsi et le perpétuent. Le narrateur l'affirme "ignorance et indigence" sont les deux piliers de ce monde injuste et condamné comme la pièce mise en "abyme" dans le roman, au titre emblématique "Chaos vaincu", le promet, comme le clame le discours de Gwymplaine. La réponse sera certes politique, mais elle suppose préparation et évolution. Les temps ne sont pas mûrs, pourquoi le discours de Gwymplaine est inaudible. Et s'il faut commencer par nourrir les affamés (ce que fait Ursus avec les enfants), il faut aussi nourrir les esprits. Le roman s'y emploie à sa façon en déconstruisant les superstitions, dont la croyance aux sorciers et au sort n'est pas la moindre, avec violence et dans la dérision. Le rire tatoué sur le visage de Gwymplaine est la marque visible de la défiguration à laquelle les pauvres sont soumis depuis des siècles : "Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles ; comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face un masque de contentement" (II, VIII, 7) Pourquoi à la question "Qu'est-ce que tu dis ?" Gwymplaine répond: "— Je prédis." Et ce qu'il prédit, c'est que le mépris n'aura qu'un temps. La Révolution française, dans ses moments les plus terribles, la Terreur (et ce sera Quatrevingt-treize), le proclamera, comme l'Empire va le découvrir d'en moins d'un an au moment où paraît le roman. L'Homme qui rit est un roman souvent difficile d'accès en raison de ses excès, mais ce sont ses excès mêmes qui en font une oeuvre particulièrement bouleversante. Il est bien, comme le disait Hugo, une oeuvre où le lecteur est contraint de "penser à chaque ligne", d'autant qu'une grande partie du texte est écrit en phrases brèves, proches de la formule, glissant souvent à la sentence. Pourquoi il vaut la peine d'être lu et médité. |
||||
A consulter : l'édition de Gustave Simon qui offre nombre d'informations sur le manuscrit, le travail de rédaction et de publication, les réactions critiques. A lire : l'article d'Umberto Eco, "« Hugo, hélas ! » La poétique de l'excès", dans Construire l'ennemi et autres écrits occasionnels, Grasset & Fasquelle, 2014. |