Les
Croix de bois, Roland Dorgelès, 1919
|
||
 Roland Dorgelès, au Front en 1915 (photographie anonyme) |
L'auteur :Il naît Laurent Lécavelé, le 15 juin 1885, à Amiens, dans un famille de la petite bourgeoisie. Son père fait le commerce de draps.Malgré cette naissance provinciale, c'est à Paris que l'enfant grandit. Après ses années de scolarité et le baccalauréat, il s'inscrit à l'Ecole des Beaux-Arts, mais très vite, dès 1904, prend le chemin du journalisme. Il travaille pour divers journaux satiriques et fréquente la bohème montmartroise dont le quartier général est le Lapin agile. S'y retrouvent, entre autres, Mac Orlan, Cendrars (qui en 1913 inscrit le Lapin agile à la fin de la Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France), Apollinaire, leurs amis peintres. Il en rapportera les souvenirs dans de nombreux récits, par exemple Les Veillées du Lapin agile (1920) ou Le Château des brouillards (1932). Dès 1907, il s'est choisi le pseudonyme de Roland Dorgelès et a commencé par s'essayer au théâtre. Lorsque la guerre est déclarée en août 1914, Dorgelès est toujours journaliste, il collabore, entre autres, à L'Homme libre, dirigé par Clémenceau. Il s'engage et va connaître le Front jusqu'en 1916 où il demande à être versé dans l'aviation. Il y fait son apprentissage de pilote et devient instructeur. En 1917, il écrit, dans la veine satirique, pour Le Canard enchaîné, fondé en 1915, par Maurice Maréchal. En 1919, son récit, Les Croix de bois, connaît un large succès. S'il n'obtient pas le prix Goncourt dévolu à Proust, il est récompensé du prix Vie heureuse (futur Fémina). La guerre va encore alimenter une grande partie de son oeuvre. Rappelons Le Réveil des morts, en 1923, qui s'intéresse à la reconstruction des territoires dévastés et aux "magouilles" qui en naissent dont la moindre n'est pas le trafic autour des cimetières militaires. Plus tard, ses réflexions sur la guerre s'enrichiront de son expérience de correspondant de guerre pour Gringoire à partir de 1939, même s'il prend ses distances, dès 1941, d'un journal dont les positions (antisémitisme, collaboration avec l'occupant) ne sont pas les siennes. Après la Grande guerre, il fait, en 1922, la connaissance d'une chanteuse, Hania Routchine qu'il épouse en 1923. Ensemble, ils vont beaucoup voyager, et ces voyages alimentent une autre partie de l'oeuvre de Dorgelès. Ce sont des romans reportages, comme La Route mandarine (1925) consacré à l'Indochine, ou La Caravane sans chameaux (1928) à l'orient entre l'Egypte et le Liban ou encore Sous le casque blanc (1941), retraçant les pages oubliées de la conquête de l'Afrique (Oui, Dorgelès, en cela, reste infiniment proche des idées les plus répandues de sa jeunesse et il est "colonialiste" avec la spontanéité et la bonne conscience des pères de la IIIe République) : "L'Histoire est un roman que se conte la Providence et j'ai fidèlement transcrit celui-ci pour payer notre dette aux conquérants obscurs morts sous le casque blanc." écrit-il dans son prière d'insérer. En 1929, il a été coopté à l'Académie Goncourt après le décès de Courteline pour lequel il avait une grande admiration. En 1955, après le décès de Colette, il en devient le président jusqu'à sa mort, en 1973. Son oeuvre, pour l'essentiel oubliée aujourd'hui, n'est cependant pas dépourvue d'intérêt, ni de qualités. |
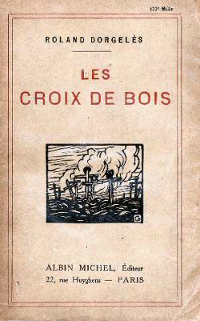 Première de couverture de l'édition de 1919 |
Le roman :Il était déjà difficile en 1919 de publier un nouveau livre sur l'expérience de la guerre, après Le Feu de Barbusse (1916) dont le succès, considérable auprès des combattants, s'imposait comme modèle, et comme tel indépassable. Sans compter qu'il y avait aussi eu Genevoix avec les trois premiers livres, publiée entre 1916 et 1918, des cinq qu'il consacre à son expérience de soldat, et Georges Duhamel dont Vie des martyrs (1917) et Civilisation (1918) ne pouvaient être oubliés.Mais Dorgelès était aussi journaliste, combattant, et sa propre vie au Front avait besoin, sans doute, de se mettre en mots, à la fois comme il l'écrit dans le roman (dernier chapitre) pour "mémoire", pour que ne disparaissent pas dans l'oubli, si difficile à enrayer, tous ceux qu'il avait côtoyés, avec lesquels il s'était battu, avait partagé une vie terrible, et dont il ne restait plus, pour beaucoup, et encore avec de la chance, qu'une pauvre croix de bois quelque part sur les champs de bataille destinés à redevenir des champs tout courts. Tolstoï disait déjà que l'herbe était victorieuse, toujours ; et sans doute aussi, comme le disait Otto Dix à propos de sa série de gravures sur la guerre, pour exorciser. Le narrateur des Croix de bois ne s'interroge-t-il pas sur ce qu'il deviendra ensuite (s'il en réchappe) "Il me semble que ma vie entière sera éclaboussée de ces mornes horreurs, que ma mémoire salie ne pourra jamais oublier" et que le monde ne sera plus sous son regard qu'un perpétuel champ de bataille potentiel (chapitre 8, "La veille des armes"). Organisation du récit : il se déploie en 17 chapitres, tous titrés, un peu sur le même modèle que le roman de Barbusse, en une succession de "scènes" de la vie quotidienne des soldats au Front. Mais Dorgelès y insère le fil rouge d'une destinée singulière, celle d'un jeune homme, Gilbert Demachy, étudiant en droit dans le civil, fils de bourgeois aisés, depuis l'engagement et le départ vers les lignes (chapitre 1) jusqu'à sa mort (chapitre 16), le dernier chapitre se présentant comme un épilogue assumé par le narrateur. Le narrateur est une figure ambiguë puisqu'il est dans le même mouvement un personnage du récit, quoiqu'effacé, et un narrateur omniscient qui peut vivre, par exemple, en première personne, l'agonie solitaire de Gilbert. Il a un nom, Jacques Larcher. En se présentant à Gilbert Demachy, il précise "J'écris", sans dire exactement quoi. Le dernier chapitre fait de lui un écrivain, auteur du récit que le lecteur vient d'achever. |
|||
| Il partage avec son personnage bien des caractéristiques ; tous deux
sont parisiens, tous deux sont cultivés, tous deux sont déplacés au
milieu des soldats qui, dans leur majorité, viennent du monde ouvrier
et/ou paysan. Tous deux, toutefois, se dépouillent progressivement de
leur vieille peau pour faire "corps" avec le groupe de combattants
auquel ils appartiennent. "Scènes de la vie militaire", le roman rapporte, comme celui de Barbusse, les "moments" du quotidien, entre cantonnements et tranchées : la question de la nourriture, les longues marches épuisantes, de jour mais le plus souvent de nuit, les attaques, celles qui sont lancées des tranchées françaises, celles qui viennent des tranchées allemandes, les bombardements, les difficiles rapports avec les populations (il est plus facile de loger des chevaux que des hommes), les lettres, les rapports complexes avec l'arrière (nostalgie, désir et rancune de ceux qui souffrent et se sentent incompris), et même une exécution pour l'exemple ; puis le récit couvrant la guerre jusqu'à sa fin, comme le signale le dernier chapitre, "Et c'est fini", le difficile retour des anciens combattants, sous le titre ironique de "Le retour du héros" (chapitre 16), avec le personnage de Sulphart que sa femme a quitté pour un autre homme, en emportant les meubles, qui se retrouve sans travail et que personne ne veut écouter, pas même sa concierge : "Ah ! monsieur Sulphart, suppliait-elle, ne me racontez plus de ces histoires de tranchées, on en a les oreilles rebattues." (chapitre 16) Si les scènes sont similaires à celles que Barbusse relate, le point de vue en est fort différent. L'exécution du soldat qui a refusé de remonter en ligne, par exemple, est développée dans toutes ses étapes (alors que Barbusse ne montrait que le lieu d'une absence) jusqu'à provoquer la nausée du lecteur ; moins terrible, le revue du "barda" (le sac du soldat) est ici exigée par la hiérarchie et n'est qu'une corvée de plus avec les risques de punitions afférents, et non comme chez Barbusse, un moment d'émotions et de partage. Comme Barbusse encore, Dorgelès ne localise pas son récit (les points du Front où se retrouvent ses soldats pourraient être n'importe où sur le terrain de la guerre), de même que les scènes rapportées ne sont pas datées, puisque le récit couvre toute la guerre ; il commence, en effet, sur les premiers envois de renforts (les soldats ont encore les pantalons rouges du début de la guerre, 1914 - début 1915, dans le chapitre 1) et se termine sur l'intensification des combats (chapitres 11 et 12, puis 14 et 15) qui vont conduire à l'armistice, confirmée par le dernier chapitre "Et c'est fini". |
||||
| Ambivalences Vivre dans la guerre, vivre la guerre, dans le récit de Dorgelès, c'est faire l'expérience d'une constante ambivalence. La guerre est détestable, éprouvante, elle altère la sensibilité, elle accentue jusqu'à la caricature les traits d'un caractère, ainsi de Sulphart qui semble voué aux récriminations et aux revendications perpétuelles ou de Bouffioux dont la pusillanimité devient sans borne faisant de lui la peur incarnée, mais dans le même temps, elle est excitante, glorifiante. Les soldats en font l'expérience qui après dix jours de combats en ligne, doivent défiler sous les yeux du général, des jeunes renforts et de la population d'un village ; furieux au départ, ce qui reste du régiment, alors, dans le rythme de la musique militaire, dans les larmes des femmes, dans le salut du général, se redresse d'orgueil et le narrateur, désabusé, de conclure : "Allons, il y aura toujours des guerres, toujours, toujours… " (chapitre 11, "Victoire") Terriblement dangereuse, la guerre est aussi un spectacle, et un beau spectacle qui peut même devenir du cirque lorsque les soldats ne sont pas concernés directement. Même s'il y a là de l'exorcisme, il n'en reste pas moins que, par moments, il arrive aux personnages de penser, comme le cavalier d'Apollinaire "Ah ! Dieu que la guerre est jolie". Ambivalence qui se manifeste aussi dans le balancement entre rire et larmes, grotesque et pathétique, aussi bien pour ce qui regarde les situations évoquées que dans le comportement des personnages. Quand les jeunes renforts arrivent sur les lignes, l'escouade se gausse de leur équipement tout neuf, et pour les accueillir, Sulphart et Lemoine, son acolyte, ne trouvent rien de mieux que de se travestir et jouer les mariés (chapitre I), scène elle-même parodique du déguisement des adolescents dans Sylvie (Nerval), la mise en scène du passé le dévalorisant dans le burlesque. Le ton est donné et bien d'autres farces seront menées, par ex. celle consistant à donner d'invraisemblables conseils culinaires, qu'il suit à la lettre, à Bouffioux devenu cuisinier (chapitre 4 "La bonne vie"). Le rire, c'est à la fois la marque de la jeunesse et l'affirmation redoublée de l'humanité ("pour ce que rire est le propre de l'homme" disait Rabelais) dans un cadre inhumain : "C’était la bataille sans ennemis, la mort sans combat" dit le narrateur au chapitre 11, pourquoi le narrateur le magnifie tout en ressentant une sorte de remords d'avoir fait rire des morts, au double sens où ce sont les morts qui riaient et où le lecteur a pu, à son tour, rire de ceux qui sont morts. Pourtant c'est ce rire, affirmation de la vie, que le narrateur choisit de remémorer en oubliant les pleurs qui, pourtant n'ont pas manqué. |
||||
|
Ambivalence aussi du rapport à "l'arrière", ce monde d'avant qui,
malgré tout, continue à vivre, lui. Nostalgie, désir mais aussi colère,
profond sentiment d'une injustice ressentie par ceux qui ne vivent plus
que dans la mort, celle des autres et la leur même qui les attend :
"Alors, on se rassied, le dos au mur, et on attend. Faire la guerre
n’est plus que cela : attendre. Attendre la relève, attendre les
lettres, attendre la soupe, attendre le jour, attendre la mort… Et tout
cela arrive, à son heure : il suffit d’attendre…" (chapitre 12
"Dans le jardin des morts") Et
même la menace continue de la mort est elle-même sous le signe de cette
ambivalence. Elle est à la fois l'horizon de tous les actes et en même
temps impossible à penser vraiment. "Mourir ! Allons donc !
Lui mourra peut-être, et le voisin et encore d’autres, mais soi, on ne
peut pas mourir, soi… Cela ne peut pas se perdre d’un coup, cette
jeunesse, cette joie, cette force dont on déborde. On en a vu mourir
dix, on en verra toucher cent, mais que son tour puisse venir, d’être
un tas bleu dans les champs, on n’y croit pas. Malgré la mort qui nous
suit et prend quand elle veut ceux qu’elle veut, une confiance insensée
nous reste. Ce n’est pas vrai, on ne meurt pas ! Est-ce qu’on peut
mourir, quand on rit sous la lampe, penchés sur le plat d’où monte un
parfum vert de pimprenelle et d’échalote ?" (chapitre 6, "Le
moulin sans ailes") |
||||
La mort, la mémoire et l'oubli
Dans l'ambivalence où le roman situe la mort : elle est là et elle n'y est pas, elle en est le sujet réel. |
 |
|||
| Elle
se manifeste aussi dans leur insignifiance. Sur le champ de bataille,
les hommes sont de minuscules créatures qu'écrasent impitoyablement des
projectiles tombés du ciel : "En regardant bien, malgré la fumée, on
les voyait encore, petits, serrés, éparpillés dans les trous."
(chapitre III, "Le fanion rouge"). Et malgré la présence des autres, la mort est toujours solitaire. Bréval, le caporal, meurt entouré, dans les pleurs de ses copains (Sulphart, Gilbert, le narrateur et les autres) mais sa mort est tout aussi solitaire et désespérée, que celle du petit soldat appelant sa maman dans la nuit, sans que personne puisse aller le récupérer sous les bombardements ou celle de Gilbert dans le bois où geignent pourtant d'autres blessés. Contre la mort qui semble frapper au hasard, mais qui tôt ou tard atteint les uns et les autres, il n'y a de protection que dans le rire. La meilleure défense c'est la dérision, plus efficace que la colère, que les réclamations contre l'injustice ou la bêtise criminelle, laquelle a bel et bien existé. Dorgelès pour ne pas prendre des positions aussi affirmées que celles de Barbusse n'en cache pas l'existence : est-il bien nécessaire d'envoyer des hommes sur un tertre dont on a suivi le minage progressif et qui va sauter d'un moment à l'autre ? "— Combien qu’ils étaient ? demanda dans le rang une voix étranglée. — Dix… répondit quelqu’un. Et quatre mitrailleurs… » (chapitre 8, "Le mont calvaire"). Barbusse écrivait son roman pour dénoncer la guerre comme instrument du capitalisme, dans laquelle ce sont toujours les mêmes qui se font massacrer pour le plus grand profit des autres, Dorgelès est sans projet politique aussi net. Si le lecteur referme le livre avec des idées pacifistes, c'est que des hommes lui ont été montrés, dans des situations extrêmes, ni plus mauvais ni meilleurs que d'autres, simplement des êtres humains s'efforçant de faire ce qu'on leur demandait, dont l'enthousiasme patriotique (c'est le cas de Gilbert) s'est érodé progressivement dans la répétition des mêmes misères et des mêmes souffrances, dans la compréhension de l'écart creusé entre cette vie et celle qui était la leur, avant la guerre, là où sont restées les familles, les femmes désirées, un écart qui ne semble pas pouvoir diminuer malgré l'assurance finale du narrateur : "C’est vrai, on oubliera. Oh ! je sais bien, c’est odieux, c’est cruel, mais pourquoi s’indigner : c’est humain… Oui, il y aura du bonheur, il y aura de la joie sans vous, car, tout pareil aux étangs transparents dont l’eau limpide dort sur un lit de bourbe, le cœur de l’homme filtre les souvenirs et ne garde que ceux des beaux jours. La douleur, les haines, les regrets éternels, tout cela est trop lourd, tout cela tombe au fond…" Livre de l'exorcisme donc, il faut dire pour pouvoir oublier, livre qui referme le passé sur le passé, à l'encontre du Feu de Barbusse qui ouvrait sur un avenir de luttes sociales. On comprend que les deux oeuvres aient connu un même succès. D'une certaine manière, elles se complétaient. |
||||
Le roman est accessible en ligne sur archive.org. A lire : un article de Jean-Yves Le Naour sur la guerre et les intellectuels (octobre 2014). |