La
France contre les robots, Georges Bernanos, 1944
|
||
 Photographie de Bernanos, dans
les années 1940 pendant son séjour
au Brésil.
Soupault, qui l'a connu en 1926,
rapporte: "Ce
qui me fascina d'abord... ce furent ses yeux, d'un bleu que je n'avais
jamais vu et que je n'ai jamais revu, ce fut son regard. Regard direct,
sincère, perçant, lumineux, un regard qu'on ne pouvait pas oublier.
Puis on l'écoutait, déjà fasciné. Une voix de tonnerre mais une voix
chaude, amicale, une voix qui éveillait des échos. Et son rire. Un rire
de géant. Un rire irrésistible et contagieux."
|
Et
d'abord soulignons tout ce qui nous écarte de cet écrivain. Son
catholicisme qui voit Dieu et le diable partout, toujours, mais
reconnaissons-le, à
son honneur, jamais dans le désir amoureux, c'est dire que ce n'est pas
un bigot. D'étranges convictions politiques qui, même une fois rompu
avec l'Action française, continuent d'irriguer une farouche haine
contre
l'idée même de République. Une vision de la France enracinée dans
un imaginaire médiéval que nous ne partageons pas étant plutôt celui de
Bernard de Clairvaux, prêcheur de croisades, que celui des
troubadours et de Chrétien de Troyes. Alors,
pourquoi cet intérêt ? A cause des contradictions mêmes du bonhomme, de
son indiscutable honnêteté...
Et aussi, de la beauté incroyable de son phrasé, de sa prose, qu'elle
soit au service de ses romans ou de ses écrits "de combat".L'écrivainIl est né le 20 février 1888, à Paris, au sein d'une famille bourgeoise aux convictions fortement enracinées dans la droite de l'époque dont les maîtres à penser s'appellent Drumont (1844-1917) et Maurras. Il mène une scolarité agitée, à la fois en raison d'une santé fragile qui multiplie les absences et de l'ennui que produit en lui l'école. Il a changé plusieurs fois d'établissement scolaire, mais toujours étudié dans des écoles religieuses. Ses convictions religieuses, il est catholique, sont aussi profondes qu'angoissées. Après des études de lettres et de droit, à Paris, années pendant lesquelles se manifeste le plus bruyamment ses engagements d'extrême-droite, faisant volontiers le coup de poing aux côtés des Camelots du Roi, les "gros bras" de l'Action française, il dirige un journal d'extrême-droite à Rouen, de 1913 à 1914, L'Avant-garde de Normandie, proche de cette même Action-Française, qui est bien ce qu'on fait de pire en ce domaine : antisémitisme, royalisme et tutti quanti, ceux pour qui la République est une "gueuse". Il attaque de tous côtés, et en particulier s'en prend à Alain qui écrit dans La Dépêche de Rouen.Bien que réformé, il s'engage au moment de la guerre de 1914. Après la guerre, il devient inspecteur dans une compagnie d'assurances, La Nationale. Il s'est marié en 1917 et son premier enfant naît en 1918. Bernanos et son épouse auront six enfants. En 1926, il publie son premier roman, Sous le soleil de Satan, dont le succès est si grand (près de 100.000 exemplaires vendus l'année de parution et des traductions dans le monde entier, dit son biographe, Jean Bothorel) qu'il quitte son travail avec l'espoir de vivre en écrivant. Il y parviendra, avec des hauts et des bas, néanmoins. Au début des années 1930, il rompt avec l'Action française, et plus le temps passera, plus sa critique deviendra virulente à l'égard d'une certaine droite, celle de Maurras, dont il a pourtant longtemps partagé les certitudes. La guerre d'Espagne va jouer, à cet égard, un rôle essentiel. Plutôt proche de Franco au départ, dès 1937, les exactions des franquistes dont il est le témoin direct à Palma de Majorque, et indirect grâce à son fils engagé aux côtés des phalangistes, vont susciter en lui une horreur salutaire dont témoigne Les Grands cimetières sous la lune (1938). Mais cette rupture ne change rien à son monarchisme, ni à son catholicisme, les deux d'ailleurs étant profondément liés, dans sa pensée. En juillet 1933, il souffre un accident de moto qui le laisse handicapé. Il doit porter un soulier surélevé au pied gauche, et marche avec difficulté, à l'aide de deux cannes. Il s'expatrie, une première fois, aux îles Baléares, sans doute pour fuir ses difficultés financières, peut-être aussi dans l'espoir d'y vivre plus économiquement qu'en France mais aussi parce que sa vie durant, Bernanos, dont la famille paternelle se vante de lointaines origines espagnoles, entretient une sorte de fantasme hispanisant. Après un bref retour en France et la nausée que soulève en lui l'atmosphère générale de ce qu'il perçoit comme "avant-guerre" bien avant la majorité de ses contemporains, il s'exile de nouveau avec comme projet de s'installer au Paraguay, mais finalement c'est au Brésil qu'il va vivre, entre 1938 et 1945, avec sa famille, dont une partie y restera définitivement, et quelques amis qui ont choisi de le suivre. Dès 1940, il manifeste son hostilité au régime de Vichy et s'engage résolument du côté de la France libre qui, par la force des choses, est celui de De Gaulle, à l'égard duquel Bernanos est réservé. Il va mettre toute sa verve et son agressivité polémique dans un travail de propagandiste pour la France libre dans la presse brésilienne, participant aux activités du Comité de la France libre de Rio de Janeiro. Et s'il rentre en France, en 1945, semble-t-il sur les instances de De Gaulle, il refuse toutes les marques honorifiques. Il meurt en 1948, d'un cancer du foie, après avoir cherché, en Tunisie, un lieu qui lui convienne mieux pour vivre. Son dernier texte est un scénario, Les Dialogues des carmélites (1947) qui sera d'abord adapté au théâtre (1952), puis à l'opéra (Francis Poulenc, 1957) avant d'être enfin filmé, en 1960, par Philippe Agostini et le père Bruckberger qui l'avait demandé à Bernanos, sur les conseils de Camus, semble-t-il. |
||||||||
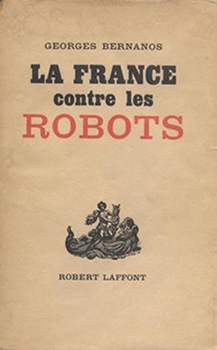 Première de couverture de l'édition de 1947 |
L'origine du texte
Il est rédigé en 1945, si l'on en croit la
date liminaire (5 janvier)
et a dû être achevé vers la fin du mois d'avril de la même année
puisque le dernier chapitre cite un extrait du discours d'ouverture de
la conférence de San Francisco (25 avril-26 juin, qui fonde l'ONU). Le
livre est d'abord
publié en 1946 à Rio ; il est précédé d'une longue
dédicace à Auguste Rendu et à son épouse qui ont dirigé et
animé le
Comité de la France Libre de Rio de Janeiro durant la Seconde guerre
mondiale et qui fut décoré de la médaille de la Résistance en avril
1945. Auguste Rendu était un ingénieur français installé au Brésil
dans les années trente qui, comme Bernanos, a choisi son camp dès 1940.
C'est par son intermédiaire que les textes de l'écrivain atteignaient
les
radios libres d'Angleterre d'abord, d'Afrique ensuite, et les
journaux résistants auxquels ils étaient destinés. |
||||||||
L'organisation du texteIl s'ouvre sur une date "5 janvier 1945" et s'organise en huit chapitres ; il développe une attaque en règle contre un avenir totalitaire, aux yeux de Bernanos, c'est-à-dire dans lequel l'économique a pris le pas sur le politique en détruisant toutes les valeurs au bénéfice du seul profit (chapitre 1). A cet avenir, il voudrait opposer l'esprit de la Révolution qu'il identifie à 1789 (c'est-à-dire la première année de la Révolution française), à l'exclusion de tout ce qui suit et qui lui paraît responsable des premiers linéaments de toutes les dictatures, parce que cet esprit de 89 est celui de la liberté: "Pour un moment, pour un petit nombre de jours d'un été radieux, la liberté fut une et indivisible." (chapitre 2), liberté de tous et de chacun que le monde "moderne" restreint de plus en plus. Cet esprit de 89 est entravé dès 1794, voire 92, parfois 91, quand se met en place, selon l'auteur, la matrice de toutes les dictatures, "la révolution réaliste et nationaliste", celle qui décrètera la conscription en masse (en 1798), confondant "Patrie" et "Etat" (chapitre 3). Il distingue aussi dans ce mot "révolution" ce qui relèverait de 1789 "une espérance accumulée" fondée sur la foi en l'homme, et ce qui appartient en propre au marxisme (la révolution allemande) fondée sur les "masses" (Bernanos honnit ce terme) "inspirée non par la foi dans l'homme, mais dans le déterminisme inflexible des lois économiques qui règlent son activité" (chapitre 4). La perte des libertés pour l'individu lui semble avoir été accélérée par la première guerre mondiale, une guerre totale, une guerre de machines et non plus, comme par le passé une guerre d'hommes, car "la guerre moderne, la guerre totale, travaille pour l'Etat totalitaire, elle lui fournit son matériel humain. Elle forme une nouvelle espèce d'hommes, assouplis et brisés par l'épreuve, résignés à ne pas comprendre, à ne pas 'chercher à comprendre'" et il conclut sur cette terrible phrase, à méditer sans aucun doute, "la Guerre Totale est la Société Moderne elle-même, à son plus haut degré d'efficience." (chapitre 5) Il peut ainsi aborder son sujet véritable, celui des robots. La machine n'est plus un outil, c'est-à-dire un prolongement de l'homme. Autonome, elle ne vise qu'à sa multiplication qui est aussi celle du profit et dans lequel l'homme n'est plus qu'un rouage parmi d'autres. La seconde guerre mondiale et les bombardements aériens en sont, pour cela, un exemple particulièrement probant. La tuerie est propre et aveugle : le tueur ne peut jamais se voir comme tel. La seconde guerre mondiale a donc multiplié les méfaits de la première en ce qui regarde la liquidation des consciences (chapitre 6). Dans ces pages se trouve en germe ce que confirmera le mois d'août 1945 et les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Rappelons au passage que la seule voix qui ait manifesté l'inquiétude qui aurait dû être celle de tous fut celle de Camus. De cette omnipotence de la technique découle le type de société qui se profile, celle du nombre, puisque par définition, "la civilisation des Machines est celle de la quantité" (profit oblige), et la société devient elle-même une machine, un système : "La société moderne est désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre." Raison pour laquelle l'homme n'y est plus lui-même "qu'un problème technique", car "l'Etat technique n'aura demain qu'un seul ennemi : —'l'homme qui ne fait pas comme tout le monde' ". Et celui-là, il faudra le mettre au pas ou l'évincer. (chapitre 7) Ainsi se dessine le royaume des imbéciles, le mot ayant à la fois sa valeur d'insulte et de constat, engageant toute sa profondeur étymologique, "imbecillus", faiblesse à la fois physique et mentale. Laminés par les changements trop rapides du monde, les deux guerres et leurs cortèges de monstruosités, nous ne sommes pas loin d'être tous des imbéciles qui avons cessé de penser par nous-mêmes, nous en remettant à de "plus compétents", affolés que nous sommes par les contradictions multiples dans lesquelles le monde des machines nous fait vivre : "Etre informés de tout et condamné ainsi à ne rien comprendre, tel est le sort des imbéciles", et Bernanos ne connaissait ni l'âge de la télévision, ni a-fortiori celui d'Internet. "Obéissance et irresponsabilité" sont les deux mots d'ordre dans lesquels il souhaite que la France ne se reconnaisse pas, elle qui "a travaillé pendant tant de siècles à former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes." (chapitre 8)Un texte polémique
Il
y a, naturellement, dans ce texte de quoi admirer, certaines pages sont
magnifiquement lyriques (sur la liberté), d'autres profondément
émouvantes (sur
la génération des jeunes gens sortis de la guerre de 1914), d'autres
d'une effrayante lucidité, pour des lecteurs du XXIe siècle,
tout autant
que de quoi contester avec aussi peu de nuances que l'auteur en met
lui-même à exposer son point de vue. Le caractère polémique du propos,
reconnaissable, en particulier, aux insultes dont il est émaillé, le
classe dans la catégorie des pamphlets plutôt que dans celle des
essais. Il
n'en
reste pas moins la défense d'une thèse, les sociétés occidentales, au
sortir de la
seconde guerre mondiale, s'acheminent toutes, vers le totalitarisme.
Le propos
en est violent, excessif, la conviction
(il est hors de doute que
la société moderne, pour Bernanos, détruit progressivement toutes les
libertés individuelles, et sur ce plan-là
on peut difficilement lui nier notre accord) s'y allie à la plus
parfaite mauvaise foi, par exemple, en présentant l'ancien
régime (la monarchie
antérieure à 1789), comme un espace de liberté dans lequel les
Parlements et les privilèges, oui, jusqu'aux privilèges, en
protégeaient l'exercice (chapitre 3). On se demande si le jeune
chevalier de La Barre, si Calas,
pour ne citer que des noms rendus
célèbres par Voltaire, si Voltaire
lui-même, roué de coups par les
valets du Chevalier de Rohan, si Diderot
enfermé à Vincennes, auraient
vraiment partagé cet avis. Mais le genre le veut, et choisir les Mémoires du
Comte de Ségur
(1753-1830), combattant avec Lafayette auprès des
Insurgés américains, certes, mais aussi ambassadeur auprès de Catherine
II, et le croire sur parole lorsqu'il fait du règne de Louis XVI celui
de la douceur de vivre est certes tendancieux, mais de bonne guerre.
Tout aussi bien que jouer un peu sur les dates, en annonçant que le
français ne sera pas langue officielle de la Conférence de San
Francisco alors qu'il l'a été (et que, partant, il a été et est
toujours langue officielle de l'ONU), ce que la délégation française
(certes, invitée de dernière minute) a obtenu avec l'appui, entre
autres, de l'URSS. Il est vrai que Bernanos aurait probablement
rétorqué que c'était plutôt un mauvais coup puisque faisant entrer
ainsi la France dans le groupe de ceux qui, marxistes de l'URSS
ou capitalistes américains, étaient les chantres de la société des
machines, il retardait d'autant la révolution souhaitée par l'écrivain.
Les torsions que fait ainsi subir à l'histoire le polémiste sont
emportées par la fièvre et l'élan de l'écriture dont l'apparente
spontanéité cache la somme de travail qui a permis de lui donner ce
"naturel" garanti par un savant dosage de termes familiers, par
quelques allusions grivoises, par les interjections et les apostrophes
au lecteur qui donnent à l'ensemble la forme d'une conversation à
bâtons rompus, plus encore que d'un discours. |
|||||||||
Il y a vingt ans [c'est-à-dire dans les années vingt du XXe siècle], le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu'alors réservée aux forçats. Oh! oui, je sais, vous vous dites que ce sont là des bagatelles. Mais en protestant contre ces bagatelles le petit bourgeois engageait sans le savoir un héritage immense, toute une civilisation dont l'évanouissement progressif a passé presque inaperçu, parce que l'Etat Moderne, le Moloch Technique, en posant solidement les bases de sa future tyrannie, restait fidèle à l'ancien vocabulaire libéral, couvrait ou justifiait du vocabulaire libéral ses innombrables usurpations. Au petit bourgeois français, refusant de laisser prendre ses empreintes digitales, l'intellectuel de profession, le parasite intellectuel, toujours complice du pouvoir, même quand il paraît le combattre, ripostait avec dédain que ce préjugé contre la Science risquait de mettre obstacle à une admirable réforme des méthodes d'identification, qu'on ne pouvait sacrifier le Progrès à la crainte ridicule de se salir les doigts. Erreur profonde ! ce n'étaient pas ses doigts que le petit bourgeois français, l'immortel La Brige de Courteline, craignait de salir, c'était sa dignité, c'était son âme. Oh ! peut-être ne s'en doutait-il pas, ou ne s'en doutait-il qu'à demi, peut-être sa révolte était-elle beaucoup moins celle de la prévoyance que celle de l'instinct. N'importe ! On avait beau lui dire : « Que risquez-vous ? Que vous importe d'être instantanément reconnu, grâce au moyen le plus simple et le plus infaillible ? Le criminel seul trouve avantage à se cacher... » Il reconnaissait bien que le raisonnement n'était pas sans valeur, mais il ne se sentait pas convaincu. En ce temps-là, le procédé de M. Bertillon n'était en effet redoutable qu'au criminel, et il en est encore de même maintenant. C'est le mot de criminel dont le sens s'est prodigieusement élargi, jusqu'à désigner tout citoyen peu favorable au Régime, au Système, au Parti, ou à l'homme qui les incarne. Le petit bourgeois français n'avait certainement pas assez d'imagination pour se représenter un monde comme le nôtre si différent du sien, un monde où à chaque carrefour la Police d'Etat guetterait les suspects, filtrerait les passants, ferait du moindre portier d'hôtel, responsable de ses fiches, son auxiliaire bénévole et public. Mais tout en se félicitant de voir la Justice tirer parti, contre les récidivistes de la nouvelle méthode, il pressentait qu'une arme si perfectionnée, aux mains de l'Etat, ne resterait pas longtemps inoffensive pour les simples citoyens. C'était sa dignité qu'il croyait seulement défendre, et il défendait avec elle nos sécurités et nos vies. Depuis vingt ans, combien de millions d'hommes, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ont été ainsi, grâce aux empreintes digitales, mis dans l'impossibilité non seulement de nuire aux Tyrans, mais de s'en cacher ou de les fuir ? Et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines. L'idée qu'un citoyen qui n'a jamais eu affaire à la Justice de son pays, devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui lui plaît, pour des motifs dont il est seul juge, ou simplement pour son plaisir, que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves, cette idée ne vient plus à l'esprit de personne. Le jour n'est pas loin peut-être où il semblera aussi naturel de laisser notre clef dans la serrure, afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour, que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition. Et lorsque l'Etat jugera plus pratique, afin d'épargner le temps de ses innombrables contrôleurs de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, à la joue ou à la fesse, comme le bétail ? L'épuration des Mal-Pensants, si chère aux régimes totalitaires, en sera grandement facilitée. La France contre les robots,
chapitre 2.
|
A lire : le texte disponible sur Gallica. |